C’est la faute de mes parents ! Et peut-être un peu à ma carte du ciel très, très favorable à cette tendance : j’aime voyager. En revanche, pas n’importe où et pas n’importe comment. La Thaïlande ou l’Amérique du Sud ne m’attirent pas. Je suis une Nordique. La Scandinavie bien avant l’Asie. Et le camping bien avant l’hôtel.
J’ai connu la tente par choix et pour le prix modique. J’ai essayé la tente-roulotte, mais j’ai su que reculer quelque véhicule tracté que ce soit, ce n’était pas aussi facile que la théorie me l’a laissé croire. Avec l’âge, vint le véhicule récréatif. Une petite caravane portée de sept pieds et demi pour commencer et depuis quelques années, un motorisé de classe B.
J’ai voyagé pendant les vacances d’été. Une seule fois pendant les vacances de la construction et plus jamais, oh ! que non. Puis, quand j’ai pu, en septembre et en juin. Depuis quelques années, je peux partir à peu près toute l’année, ce sont plutôt les rendez-vous médicaux et le besoin quand même d’être dans ma maison, sur mon terrain, bref, chez nous qui limitent mes déplacements.
J’aime me sentir libre d’aller où je veux, quand je veux.
Mais ce qui m’amène à résumer ma vie de campeuse, c’est pour souligner que depuis quelques années, je ne voyage plus de façon aussi agréable. Aussi décontractée, aussi l’esprit libre. Est-ce l’âge ? Peut-être un peu. J’ai besoin de plus de sécurité, je m’inquiète plus facilement, bref, je stresse.
Pas que l’âge pourtant.
Depuis quand ? Depuis que les campeurs peuvent RÉSERVER. Majuscules et gras, parce que ça m’énerve, et tous les synonymes possibles : être sur des charbons ardents, s’alarmer, s’angoisser, s’en faire, s’inquiéter, se faire du mauvais sang, se faire du souci, se faire du tracas, se faire un sang d’encre, se mettre martel en tête, se morfondre, se ronger les moelles, se ronger les sangs, se soucier, se tourmenter, se tracasser.
Depuis que les campeurs peuvent réserver eh bien, ils réservent. Parfois un an à l’avance. Et pas à un seul camping, à plusieurs. Pire, ils oublient d’annuler ou le font la veille.
Je déteste réserver. Je ne sais pas un an à l’avance, même pas un mois à l’avance si je vais aller là ou là, à telle date ou telle autre. Et si j’ai envie de rester plus longtemps sur le bord d’un cours d’eau ? Et s’il y a une tempête qui me retarde en route ? Et si je n’aime pas ce camping et que je n’ai plus envie d’y aller ? (Déjà arrivé, ai perdu un dépôt de 100 $) Et si…
Exemple au Québec : la Sépaq. Je voulais aller au parc Mont-Tremblant, deux nuitées dans les très beaux et nouveaux chalets EXP. Nous étions le 20 janvier, pas dans la semaine de la relâche, juste en janvier. Et je voulais y aller dans la semaine, pas le vendredi, mais un lundi et un mardi. Je jette un coup d’œil sur le site. Il y a cinq chalets. Tous loués jusqu’à la fin mars, tous les jours. Ah ! non, un seul disponible, une seule journée, le 19 février. 130 $. Un mois plus tard. Commencèrent les « et si… » Et s’il y a tempête ? Et si ça ne me tente plus ? J’appelle et je demande comment le système d’annulation fonctionne. À un mois d’avis, pas d’annulation possible. Si, pour une raison ou pour une autre, je ne peux pas y aller le 19 février, je perds 130 $! Je n’ai évidemment pas réservé et n’y suis pas allée. Je ne sacre pas, mais il m'arrive de dire des gros mots.
Aux États-Unis, ce sont les State park qui sont réservés des mois à l’avance. Les plus près de la mer comme les plus reculés. Il y a un site, Reserva America, qui nous permet de réserver dans la plupart des State park et quelques RV park. Je connais des campeurs qui réservent à deux ou trois endroits. Je comprends que les Étatsuniens du sud puissent camper à l’année, donc ils ne se gênent pas pour partir camper presque chaque fin de semaine. Mais la semaine ?
La réservation est devenue un système fort lent et déshumanisé. Il m’est arrivé d’être au Anastasia State park (St-Augustine, Floride) et aussi à Walt Disney, bien présente, devant un comptoir et je ne peux pas avoir d’emplacements. Il faut que je téléphone. Je suis là, devant une préposée qui pourrait me renseigner, me dire au moins s’il y a des emplacements disponibles, non, il faut que je téléphone à la centrale de réservations. En anglais, évidemment. Heureusement à Walt Disney, on a le droit d’avoir une traductrice. L’appel se fait à trois… au téléphone. Heureusement aussi, à St-Augustine, une fois que j’ai su qu’il n’y avait pas d’emplacements libres, la préposée a été assez gentille pour téléphoner à deux autres campings et depuis ce jour, je me rends directement au Indian Forest campground.
Il arrive que la communication entre le parc, la centrale de réservation et les ordinateurs de chaque partie concernée ne voyage pas à la vitesse de la lumière. Tu vois le camping à moitié vide et pourtant, à l’entrée, c’est indiqué « No vacancy ». Vers 11 heures, heure du « check-out », tu parles au préposé à l’accueil, il furète dans son ordinateur et parfois il te trouve un emplacement. Et si tu appelles directement à la centrale de réservation, tu cours encore plus la chance qu’elle t’en trouve, parce que les annulations arrivent sur leur écran en premier, au parc en deuxième et sur le site seulement 24 heures plus tard. Qu’on m’a dit.
Quand même du stress, de l’impatience, de l’incertitude. Du changement de camping, du changement d’emplacement : un jour sur le 48, un jour sur le 233. Tu ne peux pas partir visiter la ville, faut que tu déménages !
Je ne voyage plus aussi librement. Certains diront que c’est de l’aventure, que je ferai de belles découvertes. Ce n’est pas ce genre d’aventure que j’aime. Perdre des heures à chercher, à attendre, à m’inquiéter, à téléphoner, à espérer. Pas plus agréable des mois avant de partir que presque chaque jour si tu roules.
Encore cette année, je voudrais pédaler sur la piste cyclable Pinellas Trail, en Floride, monter au nord et me baigner dans un ou deux « spring » et finir par la visiter cette Panhandle dont tout le monde parle avec un enthousiasme communicatif. Disons, trois campings sur neuf jours. Et bien pas évident, encore. Quelques possibilités très limitées. Si je réserve telle date à l’un, pas de place à l’autre. Si j’obtiens un mercredi à l’un, il n’y a plus de place le samedi à l’autre. Et même si j’avais toutes les dates voulues, ça m’obligerait à être là à ces dates fixées des mois à l’avance. La contrainte et moi ! Aussi stressant que de ne pas savoir où je vais coucher le soir.
Je déteste réserver. Si ça continue, je vais détester voyager. Papa, maman, pourquoi vous m’avez donné le goût de voyager !
Pour lire ou visionner quelques-uns de mes comptes-rendus des voyages de ces dernières années, cliquez sur l’onglet « voyage », en haut du blogue.


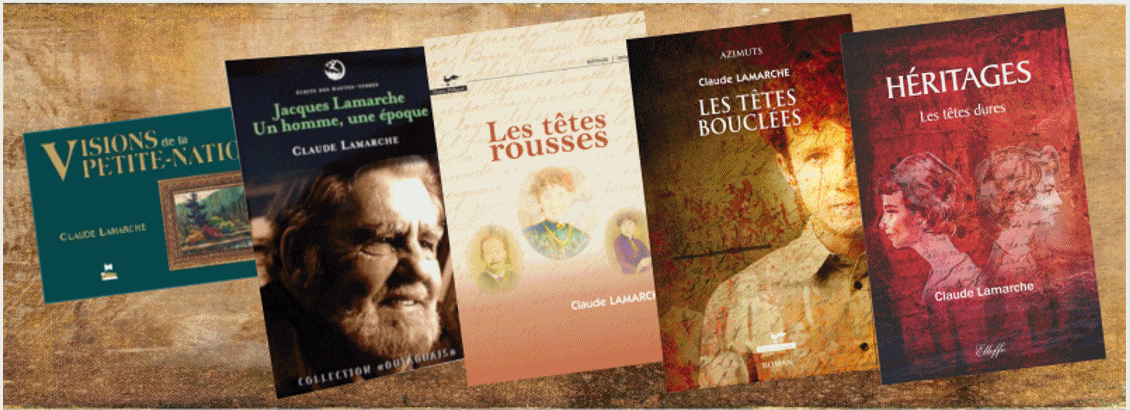





%2B(900x675).jpg)
%2B(900x501).jpg)
%2B(900x600).jpg)
%2B(600x900).jpg)
%2B(900x600).jpg)





