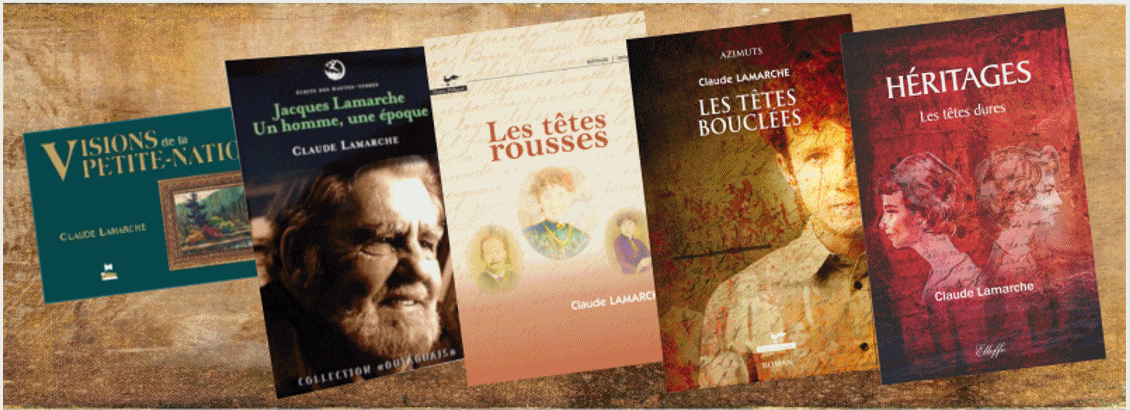Le samedi 21 mai, une journée très humide. Et venteuse. Des jardiniers plantent leurs légumes, des pêcheurs cherchent l’achigan, des enfants heureux du long congé.
Puis, vers 16 heures, des vents forts, la pluie d’abord légère, puis un horizon blanc de pluie torrentielle. Un orage terrible. Les gens quittent les lacs, d’autres s’arrêtent au bord de la route, d’autres encore, dont moi, entrent dans la maison.
Je m’assieds au salon, les fenêtres derrière moi. Je n’aime pas le vent. Je ne veux pas voir la valse des grands pins.
16 h 15
À peine trois secondes.
Chez nous.
Les jours suivants, nous verrons que ce n'est pas que chez nous.
Un bruit. Pire que le tonnerre. Pas un boum, pas un crac, un gros — jamais entendu — scroumphhh!
Trois secondes qui allaient changer notre vie (et la vie de bien des Québécois allions-nous apprendre plus tard) pour plusieurs jours à venir.
Dans la Petite-Nation (en Outaouais, pour ceux et celles qui ne savent pas) ce fut pire que le verglas.
16h18
L’« après » de ce présent si court venait de commencer.
Nous vivons dans une plantation de pins — gris et rouges —, hauts de 55 pieds, vieux de 55 ans. En face, à l’ouest, deux immenses champs où le vent peut prendre son élan.
L’« après » de ce présent si court venait de commencer.
Nous vivons dans une plantation de pins — gris et rouges —, hauts de 55 pieds, vieux de 55 ans. En face, à l’ouest, deux immenses champs où le vent peut prendre son élan.
Je me lève d’un bond. Je vois tout de suite un rideau de branches dans les vitres du devant de la maison. En même temps, je réalise que les branches n’ont pas cassé les fenêtres. Je n’ai rien. Je crie. « Louise, où es-tu? » Elle est debout dans la galerie arrière. Je la vois. Nous sommes saines et sauves.
Elle veut aller dehors. Voir si la vieille piscine hors terre a tenu le coup.
Elle veut aller dehors. Voir si la vieille piscine hors terre a tenu le coup.
Je lui crie « pas tout de suite, il vente encore, il pleut encore, d’autres arbres peuvent tomber ».
Je suis la mère qui veut protéger l’enfant en lui interdisant d’aller jouer dehors par temps d’orage.
Je suis aussi la petite fille qui ne veut pas rester toute seule à l’intérieur.
Je suis la mère qui veut protéger l’enfant en lui interdisant d’aller jouer dehors par temps d’orage.
Je suis aussi la petite fille qui ne veut pas rester toute seule à l’intérieur.
On s'abrite sous un encadrement. On se colle. On respire. Louise voit ce que j'ai vu: les arbres tombés.
16 h 40
Le vent a cessé, la pluie est intermittente.
On ouvre la porte, on enjambe les branches sur la galerie. On regarde le désastre.
Quatre énormes branches, six ou huit pouces de diamètre je dirais, sont tombés sur la gouttière. Aucun arbre déraciné. Par contre, une des branches est appuyée sur des fils électriques.
Déjà, noter les heures, déjà appeler Hydro-Québec, penser aux assurances.
C’est samedi, c’est longue fin de semaine de congé. Personne ne répond.
« Votre appel est important pour nous » chez Hydro-Québec.
« Your call is important to us » chez Aviva.
Pendant trois jours.
Noter le jour, noter l'heure. Commencer un carnet.
Si possible des noms, des numéros de téléphone.
Ça deviendra une histoire après.
Un message dans Facebook peut-être quand j’aurai du réseau. Peut-être un billet sur mon blogue.
Chacun raconte son histoire.
J'ai écrit la mienne.
Le vent a cessé, la pluie est intermittente.
On ouvre la porte, on enjambe les branches sur la galerie. On regarde le désastre.
Quatre énormes branches, six ou huit pouces de diamètre je dirais, sont tombés sur la gouttière. Aucun arbre déraciné. Par contre, une des branches est appuyée sur des fils électriques.
Déjà, noter les heures, déjà appeler Hydro-Québec, penser aux assurances.
C’est samedi, c’est longue fin de semaine de congé. Personne ne répond.
« Votre appel est important pour nous » chez Hydro-Québec.
« Your call is important to us » chez Aviva.
Pendant trois jours.
Noter le jour, noter l'heure. Commencer un carnet.
Si possible des noms, des numéros de téléphone.
Ça deviendra une histoire après.
Un message dans Facebook peut-être quand j’aurai du réseau. Peut-être un billet sur mon blogue.
Chacun raconte son histoire.
J'ai écrit la mienne.
À suivre...