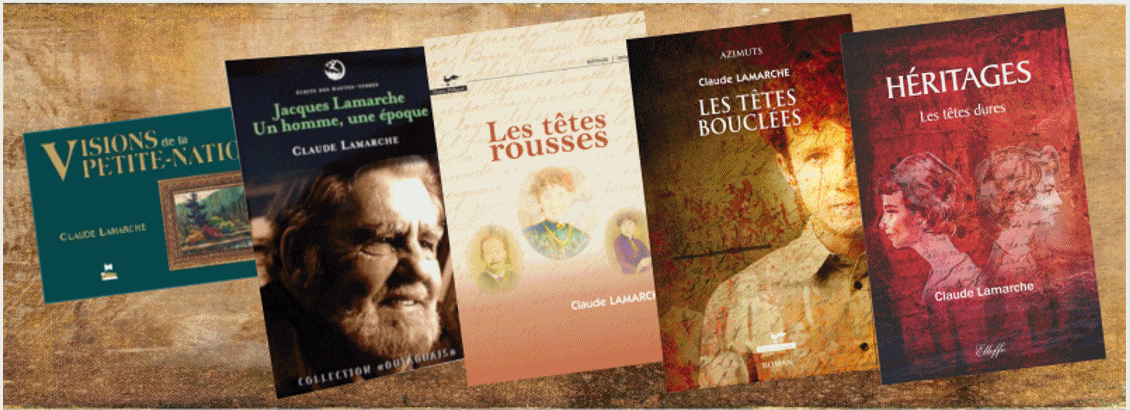Après le trois secondes du samedi 21 mai...
Dimanche 22 mai
5 h
Le sommeil était venu tard, le réveil est venu tôt.
Non seulement pas d’électricité, pas d’eau, mais plus de réseau cellulaire, donc point de données mobiles.
Rien. On est peut-être des milliers dans notre cas, mais on se sent seules au monde.
8 h On sort notre équipement de camping : réchaud au butane, popote.
On entre une chaudière d’eau (on a trois barils avec eau de pluie) pour la toilette. Des bouteilles d’eau pour le café.
On ouvre le frigo, rapidement, on prend le nécessaire. On pense aux denrées : combien de temps encore le lait, la viande, le fromage, la laitue?
On pense au verglas de 1998. Nous avions été relativement épargnées.
On pense aux Ukrainiens. Il y a toujours pire. Et on ne veut pas que ce soit nous.
12 h Le réseau cellulaire revient. L’internet aussi, vitesse de tortue.
«
Votre appel est important pour nous » chez Hydro-Québec.
«
Your call is important to us » chez notre assureur.
Ouvert 24 heures, 7 jours, vraiment?
À l’extérieur, je fais le tour de la maison, j’examine encore le désastre.
Dire qu’on venait de laver toutes les fenêtres. La gomme de pin nous donnera du plaisir, c’est certain!
Dans l’auto, je vérifie le niveau de l’essence : aux trois quarts. Mais à quoi bon la gaspiller pour aller voir ailleurs. Je branche le téléphone pour le recharger, j’écoute la radio. Peu de nouvelles de notre région.
14 h Fait rarissime, on joue aux cartes.
La concentration n’y est pas. Elle n’est nulle part.
Il est question de génératrice, de bloc d’alimentation. Comme quand nous avions un VR.
On attend.
Comme à l’hôpital, on se demande si on ne nous a pas oubliées.
16 h 30 Petit tour d’auto. Pas loin, seulement autour du village.
Pas trop de dégâts, on semble être les plus touchées.
Meilleure réception pour les données mobiles, on apprend que les stations services ne sont pas ouvertes et celles qui le sont n'ont plus d'essence. Les épiceries/dépanneurs fermés aussi.
On écrit aux ami·e·s sur Messenger.
Je communique avec mon frère à Saint-André-Avellin. Je me dis que si la panne dure, j’irai porter le contenu de mon congélateur chez lui. Mais voilà que j’apprends — fait rarissime — pas d’électricité non plus à Saint-André-Avellin.
18 h Pour souper, on a réchauffé un plat de pâtes qu’on avait congelé.
21 h On est couché. On lit un peu avec lampe frontale.
Lundi 23 mai 7 h On rejoint enfin Hydro. Bien sûr, ils sont au courant, mais on signale l’arbre tombé sur les fils du voisin.
8 hSur l'application d'Hydro-Québec, on surveille, on espère, on patiente. Sur Facebook, on voit les dégâts chez une amie de Ripon. Vraiment pire que chez nous. On essaie de la rejoindre. Pas de réponse.
10 h On rejoint la conjointe de l’élagueur déjà venu abattre des arbres chez nous. Selon elle, pour notre Petite-Nation, c’est pire que le verglas.
Ça fait 42 heures. Tant d’heures pour trois secondes! Il n’y a pas eu de « pendant ». Le « pendant » se résume à un bruit. Un coup de vent et nous étions dans cet « après » qui dure encore.
12 h Notre amie de Ripon vient nous raconter son « derecho » (le mot commence à circuler). La route bloquée, les arbres arrachés, les poteaux tombés. Les pompiers, les bénévoles, l’entraide déjà.
14 h Une voisine se promène à la recherche du réseau, arrête chez nous. On jase, on échange.
Le voisin d’en arrière qui ne vient que les week-ends vient nous voir. Son électricité provient du poteau installé sur notre terrain. Un des arbres tombés est appuyé sur « ses » fils.
16 h Électricité revenue chez mon frère à Saint-André-Avellin, je vais porter le contenu de mon congélateur.
Embrassades, échange de nouvelles, reconnaissance.
17 h Notre municipalité lance un avis par téléphone : la salle est ouverte pour eau, douches, branchement de téléphones ou tablettes. On va y brancher notre glacière de camping. On ira chaque jour. Un grand merci aux employés pour leur accueil.
21 h On est déjà au lit.
Meilleure journée, plus de communication, un peu d’espoir.
Fin du long week-end.
Mardi 24 mai 8 h On rejoint (enfin) notre assureur. En anglais d’abord, en français finalement.
Une agente rappelle, on a un numéro de référence. Ce sera une compagnie de Gatineau qui traitera notre réclamation.
On sent que ça avance.
9 h 30 Notre homme de confiance, venu pour poser une gouttière, réalise les dégâts. Muni d’une lampe frontale, il répare un tuyau de plomberie qui avait éclaté justement le matin du jour fatidique. Quand l’électricité reviendra, au moins, on aura de l’eau.
15 h Nouvelle de l’entreprise de Gatineau. Un évaluateur viendra jeudi ou vendredi.
Sur l’application Hydro-Québec, ça bouge un peu plus. Pas d’indication de retour à la normale pour notre municipalité. On apprend que plusieurs tours de notre fournisseur Internet sont pliées ou tombées.
Mercredi 25 mai 4 h du matin Une odeur de poussière me réveille. Les plinthes électriques. J’ouvre les yeux. Des chiffres rouges qui clignotent.
L’électricité est revenue. Mais pas de wi-fi.
Je ne me rendors pas. Je guette. J’espère.
Toujours pas de camions d’Hydro. Ni de nouvelles de l’assureur.
On hésite à préparer nos bagages pour le départ prévu vers l’Île-du-Prince-Édouard le lundi suivant. En fait, on songe à tout annuler.
Jeudi 26 mai 8 h 12 J’entends un petit clic! Hélas, nouvelle panne. On espère du délestage.
10 h 30 L’électricité revient et surprise, le wi-fi.
Vendredi 27 mai
12 h 30 Le voisin arrive pour le week-end, vient nous confirmer, que lui, il n’a toujours pas d’électricité.
L’évaluateur stationne dans notre entrée, se promène sur tout le terrain, examine les dégâts, évalue les travaux, monte sur le toit, trouve un trou causé par une grosse branche. Il nous explique les étapes : qui va venir, qui va réparer et quand...
20 h Un père et ses enfants arrivent, coupent les arbres, dégagent les fenêtres, ramassent les branches. On retrouve notre devanture. Cependant, pas le droit de couper l’arbre appuyé sur les fils d’Hydro.
Samedi 28 mai Toute la journée, on ramasse des branches.
Personne ne vient : ni le couvreur, ni le ramasseur de bûches, ni Hydro.
Bien décidées à ne partir vers l’Île-du-Prince-Édouard que si l’Hydro est venue couper l’arbre.
Dimanche 29 mai
11 h 30 Deux employés d’Hydro, venus de Blainville, passent nous voir, notent les travaux à effectuer pour dégager les fils qui mènent à la maison du voisin.
17 h Deux camions bleus d’Hydro longent la rue (où il n'y a que quatre résidents, je précise), et s'arrêtent chez nous. On sort de la maison comme pour accueillir le père Noël. Un premier homme, équipé d’une scie, d’une tronçonneuse et de cordage, débarque, se dirige aussitôt vers un arbre situé à proximité de l’arbre tombé, grimpe comme un alpiniste, et s’assoie sur une branche, les petites pattes ballottantes, et attend. Il nous dit qu’il attend que le courant soit enlevé pour qu’il puisse marcher sur les fils. Alpiste et funambule? On veut voir ça.
 |
| Les pieds sur le fils électrique, une main sur le cordage et l'autre qui scie. Chapeau! |
D’autres hommes arrivent, s’affairent autour de la nacelle. Peu de temps après, le petit homme retenu par une longue corde bleue marche effectivement sur le fil, se tient d’une main après une corde et de l’autre, avec sa tronçonneuse, coupe la branche qui causait le problème. Trois minutes et tout est réglé, il descend en se laissant glisser sur la corde bleue.
Il est 18 heures, leur longue journée de travail est terminée. Demain, ils iront ailleurs recommencer et faire d’autres heureux.
Le soir, on décide de partir le lendemain.
Lundi 30 mai
9 h Des couvreurs viennent poser une membrane sur le toit.
11 h Départ pour une petite vacance bien méritée.
Il reste la gouttière, la rampe, le ramassage. Ça peut attendre notre retour.
Pour nous, le derecho commence à s’estomper.
Il aura fallu neuf jours pour trois secondes.
Prochain billet : 3,000 kilomètres pour se remettre de ces trois secondes... et neuf jours.