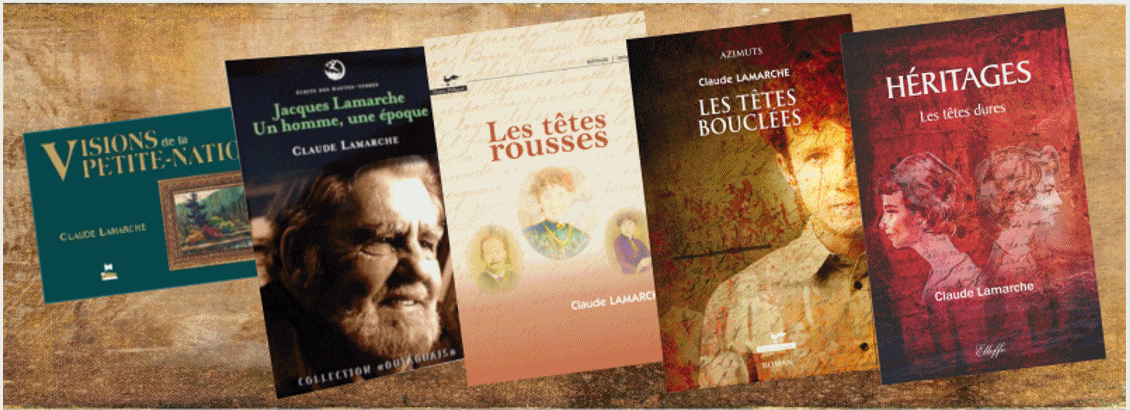Quand donc ces virgules sont-elles devenues des points? Par quelle glissade les pronoms ont-ils disparu? Quand donc, les écrivains ont-ils passé outre les règles qu’ils ont apprises au primaire : sujet-verbe-complément. Une virgule et non un point avant mais-ou-et-donc-car-ni-or?
Je n’ai rien vu venir. Où est-ce arrivé en premier? En France, au Québec? Sûrement pas aux États-Unis. Quoique je ne lis je n’ai lu que des traductions, genre John Grisham, Jeffrey Archer. Qui fut le premier ou la première qui a osé? Qui a choisi la liberté comme le jour où on a décidé de « reconstruire » un dessert, qu’il soit pouding chômeur ou savarin.
Je ne suis ni professeur ni étudiant à la maîtrise. Lectrice et observatrice seulement. Je tire donc aléatoirement, tout en ratissant large. Aussi large que mes lectures me mènent. Comme je ne suis plus à l’âge d’un cours universitaire pour étudier l’évolution du style littéraire, je folâtre ou feuillette dans plus accessible, là où je me fais croire que je n’ai pas d’âge : sur Internet. Je lis ailleurs, je cherche, je farfouille, je lis autre.
J’ai eu un haut le cri quand j’ai lu voulu lire Le jeune homme sans avenir de Marie-Claire Blais sans point aucun pendant des centaines de pages. Ou sans paragraphes.
Ce serait donc toujours ainsi, l’émergence de ces sons, ces images, quand, pensait Daniel, tout spectacle de la douleur vous pénètre, fût-elle celle que subissait un moineau, un poussin appelant sa mère quand le balayait la poussière des rues, tout enfant, si petit soit-il, de cet univers souvent en détresse, réclamait le cœur aussitôt perforé de Daniel, son regard haletant, cette patience bien qu’inutile, laquelle semblait sans limites, de voir et de souffrir par l’autre, même l’infiniment petit dans sa lutte, ainsi dans cet aéroport dont on venait d’annoncer la fermeture, les vols sans départs ni arrivées, on ne savait encore pour combien de temps,
À ne point pouvoir lire du Marie-Claire Blais, j’ai appris plus sur la lectrice que j’étais (et que je suis encore un peu) que l’auteure qu’elle est devenue. Et je m’en désole.
Et puis quelques années plus tard, j’ai lu facilement La dévorante de Lynda Dion qui a utilisé le même processus. Je comprends donc qu’on ne peut pas aimer toutes les musiques.
Si je comprends bien l’écriture a suivi la musique : on écrit comme on joue. Comme on l’entend, comme on lit. Visiblement.
D’autres, comme Marie NDiaye dans Les trois femmes puissantes, jouent encore selon la méthode classique. Et appassionato.
Était-ce parce que cet homme débraillé avait perdu toute légitimité pour porter sur elle un regard critique ou déçu ou sévère, ou parce que, forte de ses trente-huit ans, elle ne s’inquiétait plus avant toute chose du jugement provoqué par son apparence, elle se dit en tout cas qu’elle se serait sentie embarrassée, mortifiée de se présenter, quinze ans auparavant, suante et fatiguée devant son père dont le physique et l’allure n’étaient alors jamais affectés par le moindre signe de faiblesse ou de sensibilité à la canicule, tandis que cela lui était indifférent aujourd’hui et que, même, elle offrait à l’attention de son père, sans le détourner, un visage nu, luisant qu’elle n’avait pas pris la peine de poudrer dans le taxi, se disant, surprise : Comment ai-je pu accorder de l’importance à tout cela, se disant encore avec une gaieté un peu acide, un peu rancuneuse : Qu’il pense donc de moi ce qu’il veut, car elle se souvenait de remarques cruelles, offensantes, proférées avec désinvolture par cet homme supérieur lorsque adolescentes elle et sa sœur venaient le voir et qui toutes concernaient leur manque d’élégance ou l’absence de rouge sur leurs lèvres.
Et puis il y a écrire comme on parle. La déesse des mouches à feu de Geneviève Pettersen.
C’était toujours pareil : ma mère sautait sur mon père, il la laissait s’énerver pis fesser un peu, pis il l’accotait dans un mur pour l’arrêter. Là, elle devenait encore plus folle. Elle lui crachait souvent dans les yeux pis elle le traitait de noms. Après une couple de minutes, elle finissait par se calmer. C’est là que mon père la lâchait. Il la laissait aller tranquillement parce que des fois elle faisait semblant d’être calme pour pouvoir lui en recrisser une.
Je ne conclus rien, je ne juge point, j’observe, je l’ai déjà dit. Nous (les auteurs québécois) n’en sommes plus à chercher notre identité, nous nous sentons universels, même si quelques Français – académiciens, libraires, éditeurs, journalistes — nous jugent encore à l’ère folklorique et croient que nous sommes mi-américains mi-français dans notre écriture, comme en tout. On n’a plus de preuves à fournir. On peut écrire comme on veut pourvu que les éditeurs veuillent bien nous publier et les lecteurs nous lire.
Quant à moi, même si j’ai quitté les bancs d’école il y a une bonne quarantaine d’années, je vois bien que je traîne encore ce préjugé défavorable pour tout ce qui n’est pas classique et soigné.
Mais justement, je me soigne, comme on dit. En cherchant des extraits pour ce billet, je vois que la lecture est encore la meilleure guérison : plus je lis, plus j’accepte les styles familiers, moins je classe, moins j’étiquette. Le plaisir seul guide mes choix et j’oppose à mes vieux jugements un peu d’ouverture d’esprit. Et je ne ferme plus un roman seulement parce que j’ai vu le mot « canceller », pas plus que je fermerais le livre si un jour j’aperçois « kiffé la teuf! » (aimer la fête, m’a appris Anne-Marie Beaudoin-Bégin dans La langue rapaillée) ou de lire les jeunes jouer au « gouret de salon » dans un livre étasunien traduit en France.
Je ragerais, je soupirerais, je sourcillerais, mais je poursuivrais. Ce que je n’aurais pas fait il y encore quelques années.
Et puis, dans mes recherches, j’ai constaté, une fois de plus, que d’autres ont déjà réfléchi à la question. Là>>> Ils ont même abordé les nouvelles technologies en abordant l’écriture du web et ces raccourcis des gazouillis dit twits : # et @ auxquels je m’habitue mal, faute de les utiliser. C’est comme les textos à la télévision : comme si je portais mes lunettes toute la journée. Grrr….
Et pourquoi pas une fin ouverte, sans conclusion. Parce qu’il n’y en a pas. L’écriture est sans fin.